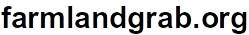Novethic | le 14 octobre 2009
Anne Farthouat
La Chine dispose de 9% des terres arables de la planète pour nourrir 20% de la population mondiale. Or, le recul grandissant de ces terres labourées rend le défi de plus en plus difficile. Si le recours à davantage d'importations est inévitable, la « délocalisation » de l'agriculture semble aussi être une solution envisagée.
La Chine frôle la ligne rouge. La surface agricole minimale pour subvenir aux besoins des chinois sera bientôt atteinte. Fixée à 1,8 million de mu (120 millions d'hectares), elle est aujourd'hui d'à peine 1,826 million de mu. Conséquence directe de l'urbanisation et de l'industrialisation massives qui bouleversent le paysage chinois depuis les années 80, le recul des terres arables est désormais une préoccupation majeure pour le gouvernement.
Depuis la fin des années quarante, plus de 600 villes sont sorties de terre, dont 90 qui comptent aujourd'hui plus d'un million d'habitants. La réquisition des parcelles arables pour construire sans cesse de nouveaux logements est donc devenue monnaie courante. Une pratique longtemps encouragée par le gouvernement via sa politique de réquisition-compensation – système dans lequel les paysans reçoivent une compensation financière en cas de réquisition de leurs terres pour un projet de construction immobilière ou industrielle-. Du point de vue règlementaire, chaque parcelle réquisitionnée est censée être « compensée » par un équivalent de terrain, libéré par la consolidation de petites parcelles ou la reprise d'anciennes installations industrielles. Or, la vitesse à laquelle disparaissent les terrains dédiés à l'agriculture a pris de court les dirigeants chinois. En cause : le marché foncier, essentiellement fondé sur la propriété publique des terres, qui manque sévèrement de transparence. En 2008, plus de 60 000 cas d'utilisations illégales de terres ont ainsi été signalés, d'après les statistiques du ministère des Terres et des Ressources.
En 2009, 420 000 hectares de terre seront pourtant consacrés à de nouvelles constructions. Lu Xin She, ministre des Terres et des Ressources, a donc promis de renforcer la surveillance et les peines concernant les occupations illégales de terres arables, allant même jusqu'à faire ouvrir une ligne téléphonique de dénonciation. Pour le gouvernement, l'enjeu est de taille : il s'agit d'assurer le développement économique, de faire face aux nouvelles pratiques alimentaires des Chinois, tout en protégeant ces terres labourées. Un défi que le ministre entend bien relever : « si nous parvenons à transformer les modes d'utilisation et de gestion des terres et à changer le modèle de développement économique, alors nous pourrons garantir une quantité en surface suffisante de terres destinées à la construction et jusqu'à 120 millions d'hectares de terres labourées. »
Délocaliser l'agriculture, une solution à peine dissimulée
Bien sûr, le recours à davantage d'importations est inévitable. Ne serait-ce que pour assurer la demande grandissante de viande et les nouvelles habitudes alimentaires des Chinois. Mais les dirigeants semblent également miser sur une toute nouvelle stratégie : la location, voire l'achat, de terres cultivables à l'étranger. En 2006 déjà, Pékin avait signé des accords de coopération agricole avec plusieurs États africains, qui ont permis l'exploitation de 14 fermes expérimentales en Zambie, au Zimbabwe, en Ouganda et en Tanzanie. La République Démocratique du Congo a quant à elle cédé 2,8 millions d'hectares à la Chine, pour qu'elle y réalise la plus grande exploitation mondiale d'huile de palme. Et plus récemment, une société mixte sino-kazakhe a loué pour dix ans 7000 hectares de terres près de la frontière avec le Kazakhstan, pour exploiter des champs de soja et de blé.
Controversées, ces cessions de terres sont souvent mal vécues par les populations locales, qui dénoncent un pillage organisé des ressources. C'est d'ailleurs l'achat par la Corée du Sud de la moitié des terres arables malgaches qui avait mis le feu aux poudres en novembre 2008, et déclenché les sanglantes émeutes de Madagascar. Évidemment, les paysans kazakhes ne voient pas non plus d'un très bon œil l'arrivée des quelques 3000 collègues chinois sur l'exploitation d'Alakol. Quant aux agriculteurs africains, ils doivent s'attendre à accueillir près d'un million de chinois dans les fermes expérimentales (ceux-là mêmes dont les terres ont été réquisitionnées), d'après le consultant agricole Jean-Yves Carfantan. Alors évidemment, Pékin préfère parler de « transfert de technologies » que de délocalisation. Mais il semble probable qu'une grande partie de la production sera exporté vers la Chine.
La Chine n'est pas seule sur ce créneau. Ce phénomène de cessions de terres tend à se développer depuis les crises alimentaire et économique. D'après l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, ces cessions concerneraient 15 à 20 millions d'hectares, pour 15 à 21 milliards d'euros d'investissement. Aux côtés de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Corée du Sud et du Japon, la Chine fait partie des plus gros investisseurs. Ils totalisent plus de 7,5 millions d'hectares de terres exploitées à l'étranger.