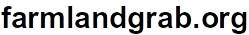Des agriculteurs français participent à un rassemblement organisé par l'Union de Coordination Rurale pour protester contre l'accord UE-Mercosur, devant une chaîne de supermarchés dans la ville de Saint Quentin-Fallavier près de Lyon, France, le 26 novembre 2024. (Photo de Mathieu Prudhomme/Anadolu via Getty Images)Euractiv | 16 Apr 2025
Des agriculteurs français participent à un rassemblement organisé par l'Union de Coordination Rurale pour protester contre l'accord UE-Mercosur, devant une chaîne de supermarchés dans la ville de Saint Quentin-Fallavier près de Lyon, France, le 26 novembre 2024. (Photo de Mathieu Prudhomme/Anadolu via Getty Images)Euractiv | 16 Apr 2025En Europe, l'appropriation de terres agricoles par d'autres acteurs, tels que des investisseurs et des supermarchés, suscite des inquiétudes en faisant grimper les prix et en réduisant l'accès des futurs agriculteurs, ainsi qu'en menaçant la sécurité alimentaire et la durabilité de l'UE.
La nouvelle a fait la une des journaux en Irlande la semaine dernière : un producteur de pommes de terre de la région de Dublin a légué à ses proches un héritage de 95 millions d'euros, provenant en grande partie de la vente d'un terrain pour y construire un centre commercial.
Le cas n'est pas isolé. La captation de terres agricoles pour d'autres activités peut être observée ailleurs en Europe.
En février dernier, Christophe Hansen, le commissaire européen à l'agriculture, a déclaré que le fait que des acteurs autres que les agriculteurs, tels que les supermarchés, les investisseurs étrangers et les fonds d'investissement, achètent des terres agricoles exerce une pression à la hausse sur les prix et rend difficile l'accès à la propriété foncière pour les agriculteurs, en particulier les plus jeunes.
Ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà en 2011, la Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources mettait en garde contre l'occupation des terres naturelles et agricoles par des bâtiments et des infrastructures, un processus connu sous le nom d'imperméabilisation des sols ou d'artificialisation.
En 2022, une analyse de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a montré que plus de 97 700 km2 de terres dans l'UE avaient été convertis en surfaces imperméables. Depuis 2023, le Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA) tire la sonnette d'alarmesur « le rythme rapide » de l'artificialisation des terres, qui, selon lui, « sape la résilience et la durabilité des systèmes agricoles ».
La semaine dernière, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur une nouvelle directive relative à la surveillance des sols, s'engageant à « ne pas accaparer de nouvelles terres d'ici 2050 ». Pour le CEJA, cependant, il ne s'agit que d'une déclaration de principe, sans « aucune voie concrète » pour atteindre cet objectif, un « échec », selon les jeunes agriculteurs, « qui doit être traité par le biais du prochain projet pilote de l'Observatoire des terres de l'UE ».
Comme annoncé dans sa vision pour l'agriculture, la Commission européenne prépare un observatoire européen des terres pour surveiller l'accès à la terre, en mettant l'accent sur les prix des terrains et la concentration de terrains.
Lors d'un groupe de travail avec des représentants des agriculteurs et des États membres qui s'est tenu à Bruxelles le 10 avril, la Commission a annoncé qu'un budget d'un million d'euros avait été alloué à la phase pilote du projet.
Le secrétaire général de l'Organisation européenne des propriétaires fonciers (ELO), Jürgen Tack, a déclaré à Euractiv que l'initiative pourrait s'avérer utile. Il a toutefois souligné la difficulté de collecter des données auprès des agriculteurs et des propriétaires fonciers.
« Nous devons garantir aux agriculteurs que les données seront agrégées et ne seront pas utilisées contre eux », a-t-il déclaré.
Pour Jürgen Tack, la question n'est pas tant d'identifier les propriétaires des terres que d'empêcher que davantage de terres ne soient « retirées de l'agriculture » et que la qualité des sols ne se dégrade.
À cet égard, il s'agit surtout de la fracture entre la propriété et la location des terres agricoles, d'après Jürgen Tack.
« Quand on est propriétaire de sa terre, elle devient son capital ; cela incite à investir dans sa qualité sur le long terme. Mais quand on la loue, elle devient une marchandise, on se désintéresse de sa qualité sur le long terme. »
Selon Jürgen Tack, la solution consiste à augmenter la taille des exploitations agricoles. « Avec la transition environnementale et les innovations nécessaires, nous devons accepter que les exploitations agricoles doivent s'agrandir pour rentabiliser les investissements. »
Il appelle l'UE à encourager cette tendance en cessant de donner la priorité à l'allocation des fonds de la politique agricole commune (PAC) à « ceux qui en ont le plus besoin », comme indiqué dans la vision de la Commission pour l'agriculture, et en les orientant plutôt vers « ceux qui le méritent le plus ». « L'argent devrait aller en priorité à ceux qui sont productifs et durables », explique-t-il.
Pour lui, c'est la qualité du sol qui devrait guider l'utilisation des terres, afin que « ce qui est juste » aille « au bon endroit ».