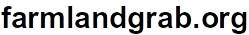Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi (à gauche), le président de la Banque africaine de développement (BAD) Akinwumi Adesina (à gauche) et la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan après avoir assisté à la réunion sur le développement durable et la transition énergétique du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, le 19 novembre 2024. LUDOVIC MARIN / AFP
Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi (à gauche), le président de la Banque africaine de développement (BAD) Akinwumi Adesina (à gauche) et la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan après avoir assisté à la réunion sur le développement durable et la transition énergétique du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, le 19 novembre 2024. LUDOVIC MARIN / AFPLe Monde | 11 décembre 2024
En Afrique, un risque d’accaparement des terres derrière la course aux crédits-carbone
Le président de la Banque africaine de développement met en garde contre une délocalisation à bas coût des projets de compensation sur le continent.
Par Laurence Caramel
L’Afrique est-elle à la veille d’un nouveau cycle d’accaparement des terres, non pas pour sécuriser les approvisionnements alimentaires de pays tiers, comme à la fin des années 2000, mais pour produire les crédits-carbone destinés à compenser les émissions des gros pays pollueurs ou celles des entreprises ayant pris pour engagement d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 ?
Cette crainte est exprimée par le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, dont l’institution défend pourtant avec énergie la mise en place de marchés du carbone sur le continent. A Bakou, fin novembre, en marge de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP29), celui qui fut auparavant ministre de l’agriculture du Nigeria a déploré que « plusieurs pays abandonnent des parties entières de leur territoire pour des crédits-carbone vendus à un prix inférieur à leur valeur, et avec elles, leur souveraineté et la possibilité qu’ils auraient d’en faire usage pour réaliser leurs propres objectifs climatiques ». « C’est ce que j’appelle du “carbon grab” [de l’accaparement de carbone] », a-t-il dénoncé, empruntant pour l’occasion le vocabulaire des défenseurs du climat ou des droits humains, très critiques à l’égard de ces mécanismes de compensation.
Les contrats de concession annoncés fin 2023 par la société émiratie Blue Carbon LLC restent à ce jour les plus spectaculaires : 1 million d’hectares au Liberia, 8 millions d’hectares en Zambie, soit l’équivalent, pour chacun d’eux, de 10 % du pays, 7,5 millions d’hectares au Zimbabwe (20 % de la superficie nationale). Aucun détail n’a filtré sur le contenu des accords.
« Avant de s’engager dans de telles cessions, les gouvernements doivent s’assurer que les populations qui vivent sur ces terres sont consentantes, qu’elles ne vont pas être privées de leurs moyens de subsistance. Les processus de consultation demandent du temps, et la rapidité avec laquelle ces accords ont été signés laisse penser qu’ils n’ont pas été menés de manière satisfaisante. Cela illustre une pression croissante sur les terres, car ce sont des actifs qui vont prendre de la valeur. Plus on s’approchera de 2050, plus la demande en crédits-carbone issus de projets de plantation ou de protection des forêts augmentera », observe Gareth Phillips, responsable, au sein de la BAD, de la division chargée du financement de la lutte contre le changement climatique.
« Quantités irréalistes de séquestration terrestre du carbone »
Les gouvernements ont intégré l’utilisation des puits de carbone naturel comme un puissant levier dans leur stratégie climatique. En examinant les engagements des Etats inscrits dans les contributions déterminées au niveau national déposés auprès des Nations unies, le cabinet de conseil australien Climate Resource constate, dans son étude « The Land Gap Report », publiée en novembre 2023, que plus d’un milliard d’hectares sont utilisés pour absorber du carbone, que ce soit par la plantation d’arbres ou par la restauration de terres dégradées. Cela représente presque la superficie des Etats-Unis.
Outre le risque de voir les pays développés différer par ce biais leur sortie des énergies fossiles, l’étude estime que « ces quantités irréalistes de séquestration terrestre du carbone ne peuvent être atteintes sans des impacts négatifs importants sur les moyens de subsistance, les droits fonciers, la production alimentaire ». Des pays comme la Corée du Sud, le Japon, la Suisse ou Singapour ont déjà indiqué qu’une partie de leurs résultats d’atténuation reposera sur l’achat de crédits internationaux, et des accords ont été signés avec des pays en développement parmi lesquels plusieurs pays africains (Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Sénégal, Zambie…).
L’accord de Paris sur le climat prévoit l’échange d’émissions de CO2 entre pays dans le cadre des marchés du carbone dont les règles ont été finalisées à Bakou. Celles-ci garantissent notamment que ces transactions soient bien enregistrées dans les bilans nationaux afin d’éliminer les doubles comptages, ce qui conduirait à surestimer le chemin parcouru pour contenir l’augmentation moyenne des températures en dessous de 1,5 °C. L’Etat qui vend ses réductions d’émissions ne peut ainsi les comptabiliser dans ses propres résultats. Pour un pays industrialisé, ou pour une entreprise qui s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, il peut être plus facile et surtout moins coûteux de délocaliser une partie de ses efforts.
C’est là l’autre argument avancé par M. Adesina pour dénoncer un accaparement du carbone africain à vil prix : « Alors que le prix du carbone en Europe est élevé et peut atteindre 200 dollars [190 euros] par tonne en raison du système d’échange de quotas d’émissions mis en place par l’Union européenne, il varie entre 3 et 10 dollars la tonne en Afrique », explique-t-il en faisant référence au commerce des crédits forestiers aujourd’hui réalisé sur des marchés volontaires du carbone échappant à toute régulation internationale.
Loi des marchés
Les pays du bassin du Congo, dont les forêts tropicales humides séquestrent un quart du carbone forestier mondial, réclament ainsi un ajustement des prix. « Nos forêts contribuent à sauver l’humanité. Rien ne justifie que le carbone capté à la sortie des usines européennes soit davantage rémunéré que celui que nous absorbons avec nos arbres », plaide la ministre de l’environnement de la République démocratique du Congo, Eve Bazaiba.
Du point de vue du climat, Mme Bazaiba a raison : une tonne de carbone possède la même valeur, où qu’elle soit soustraite de l’atmosphère. Mais ce n’est pas la loi des marchés. « Les marchés du carbone mis en place par l’Union européenne, la Californie, la Nouvelle-Zélande ou la Chine, pour ne citer que quelques exemples, ne sont pas connectés entre eux. Ils ont leurs propres règles, élaborées en fonction de leurs objectifs climatiques. Le marché européen, qui ne couvre pas le secteur forestier, cible les entreprises d’électricité et les secteurs industriels à forte intensité énergétique en leur attribuant des quotas d’émissions. Les prix élevés de la tonne de carbone [environ 70 euros actuellement] sont une pression pour inciter les industriels à adopter des technologies moins polluantes. Avoir un prix mondial du carbone supposerait d’avoir un seul marché, avec un seul régulateur. Nous n’en prenons pas le chemin », explique Marc Baudry, professeur d’économie à l’université Paris-Nanterre.
Les pays du bassin du Congo, dont les forêts tropicales humides séquestrent un quart du carbone forestier mondial, réclament ainsi un ajustement des prix. « Nos forêts contribuent à sauver l’humanité. Rien ne justifie que le carbone capté à la sortie des usines européennes soit davantage rémunéré que celui que nous absorbons avec nos arbres », plaide la ministre de l’environnement de la République démocratique du Congo, Eve Bazaiba.
Du point de vue du climat, Mme Bazaiba a raison : une tonne de carbone possède la même valeur, où qu’elle soit soustraite de l’atmosphère. Mais ce n’est pas la loi des marchés. « Les marchés du carbone mis en place par l’Union européenne, la Californie, la Nouvelle-Zélande ou la Chine, pour ne citer que quelques exemples, ne sont pas connectés entre eux. Ils ont leurs propres règles, élaborées en fonction de leurs objectifs climatiques. Le marché européen, qui ne couvre pas le secteur forestier, cible les entreprises d’électricité et les secteurs industriels à forte intensité énergétique en leur attribuant des quotas d’émissions. Les prix élevés de la tonne de carbone [environ 70 euros actuellement] sont une pression pour inciter les industriels à adopter des technologies moins polluantes. Avoir un prix mondial du carbone supposerait d’avoir un seul marché, avec un seul régulateur. Nous n’en prenons pas le chemin », explique Marc Baudry, professeur d’économie à l’université Paris-Nanterre.
Les crédits issus des pays amazoniens ou des pays forestiers africains sont le meilleur instrument de compensation à bas coût. Récemment, de nombreuses études ont cependant montré qu’en raison du manque de contrôle ou d’hypothèses erronées, les réductions d’émissions promises n’étaient pas au rendez-vous. Ces scandales ont conduit à renforcer les critères des standards privés utilisés pour certifier les projets forestiers vers lesquels se portent les entreprises. Les règles adoptées à Bakou sont aussi censées mieux prévenir de possibles dérives et mieux rémunérer la protection des forêts tropicales. En attendant – avant que leur adoption porte ses effets –, la tonne du carbone forestier africain se négocie entre 9 et 11 dollars sur les contrats à terme à cinq ans.